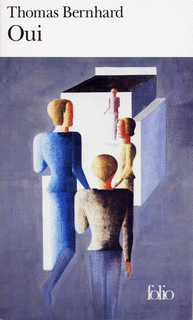Le Plancher
de Perrine Le Querrec
Le Plancher de Jeannot, c’est un grand morceau de parquet couvert de poinçons et de lettres majuscules qui vitupèrent l’Eglise et sa manipulation des consciences à travers toute une gamme d’outils inventés par elle pour voir à travers nos rétines et commettre toute sorte de crapuleries. Tour à tour considéré comme l’expression d’une psychose brute, puis celle d’un art tout aussi brut, le Plancher a terminé sa course là où bien peu d’autres oeuvres d’art achèvent la leur : placardé sur les murs de l’hôpital Sainte Anne, dans le 14è arrondissement de Paris, où elle est toujours visible pour, selon le Professeur Jean-Pierre Olié, à l’origine de l’acquisition, combattre la honte et les préjugés qui pèsent sur les maladies mentales. Pourtant, au-delà de ces différents attributs, qui sonnent comme autant de ces noms que l’on donne aux choses qui dépassent notre compréhension et nous font entrevoir les limites du langage, le Plancher de Jeannot, c’est peut-être avant tout l’expression d’un besoin de s’exprimer, précisément, de « déverser le trop-plein » lorsque la coupe est pleine, comme Perrine Le Querrec imagine que Jeannot et sa soeur Paule devaient le faire dans leur intimité d’enfants qui se sont vus imposer comme règle : « si je ne crie pas, tout ira bien ».
Exorcisme
Vu comme cela, on saisit mieux comment ce plancher a pu venir chatouiller l’imagination d’un écrivain, sans doute tout aussi habité par le besoin d’écrire que Jeannot, face à ses lattes de bois, ressentait celui de déverser ce trop-plein, ce tout qu’on n’arrive pas toujours à bien appréhender mais que Jeannot juge coupable puisque lui - il le clame - est innocent ; entre inadaptés, on se comprend. Du moins, on essaye. Ainsi, Le Plancher de Perrine Le Querrec, publié dans la petite maison Les doigts dans la prose et disponible sur le site de l’éditeur, tente d’établir la genèse de l’oeuvre en retraçant l’existence de l’artiste, Jeannot, dernier d’une fratrie de soeurs, fils presque inespéré et né après un mort, coincé entre un père violent, une mère démissionnaire et l’effroyable indifférence des deux cents âmes du village béarnais où la famille a immigré et dont on n’imagine que trop bien la manière dont ils interdisaient à leurs enfants de jouer avec ceux de la sorcière : l’innocence des honnêtes gens, qu’on verrait bien devenir « la non-sens » en parlénigme.
L’évocation de la langue d’Enig Marcheur n’est pas frivole : comme Hoban raconte son histoire post-apocalyptique dans la langue de ses personnages, reliquat et interprétation neuve de la nôtre, Perrine Le Querrec écrit dans celle de Jeannot, une langue déchiquetée, martyrisée, qui fait abstraction de la syntaxe et fonctionne par association d’idées. Ce travail, à l’origine d’un texte splendide, très imagé et remarquablement maîtrisé, au-delà de sa beauté formelle et de la puissance qu’elle emporte, pourtant considérables, présente deux avantages : d’une part, l’information nous est livrée brute, telle que ressentie par les personnages, sans recul ni jugement ; de l’autre, consciente, encore une fois, que le langage, c’est la pensée, l'auteur nous permet par ce biais de nous mettre à la hauteur de Jeannot et, dès lors, de suivre et comprendre le cheminement intellectuel qui le conduira à la réalisation du Plancher. D’une part, on convoque les sentiments ; de l’autre, l’intelligence du lecteur. Ensemble, les deux fonctionnent parfaitement.
Ainsi, petit à petit, on voit surgir des thèmes et, avec eux, des termes qui prennent de plus en plus d’importance, au point d’être imprimés en majuscules, puis gravés avec récurrence dans la chaire du parquet. Ce sont les obsessions de Jeannot. Le basculement s’opère au cours d’une formidable parodie de procès où, aux côtés des morts, on règle ses comptes avec le passé, le monde et les vivants comme dans un rituel vaudou, coiffe et masque qui font peur compris. Alors, on voit apparaître ce désir, qui est bien plus un besoin, d’évoquer enfin ce qu’on a trop longtemps tu. C’est un procès de l’âge de fer, violent et arbitraire : on abat des coups de fourches sur les accusés absents, puis, en vrac, on balance toutes les obsessions dans un grand feu de joie. Voilà, pour l’oeuvre.
L’évocation de la langue d’Enig Marcheur n’est pas frivole : comme Hoban raconte son histoire post-apocalyptique dans la langue de ses personnages, reliquat et interprétation neuve de la nôtre, Perrine Le Querrec écrit dans celle de Jeannot, une langue déchiquetée, martyrisée, qui fait abstraction de la syntaxe et fonctionne par association d’idées. Ce travail, à l’origine d’un texte splendide, très imagé et remarquablement maîtrisé, au-delà de sa beauté formelle et de la puissance qu’elle emporte, pourtant considérables, présente deux avantages : d’une part, l’information nous est livrée brute, telle que ressentie par les personnages, sans recul ni jugement ; de l’autre, consciente, encore une fois, que le langage, c’est la pensée, l'auteur nous permet par ce biais de nous mettre à la hauteur de Jeannot et, dès lors, de suivre et comprendre le cheminement intellectuel qui le conduira à la réalisation du Plancher. D’une part, on convoque les sentiments ; de l’autre, l’intelligence du lecteur. Ensemble, les deux fonctionnent parfaitement.
Ainsi, petit à petit, on voit surgir des thèmes et, avec eux, des termes qui prennent de plus en plus d’importance, au point d’être imprimés en majuscules, puis gravés avec récurrence dans la chaire du parquet. Ce sont les obsessions de Jeannot. Le basculement s’opère au cours d’une formidable parodie de procès où, aux côtés des morts, on règle ses comptes avec le passé, le monde et les vivants comme dans un rituel vaudou, coiffe et masque qui font peur compris. Alors, on voit apparaître ce désir, qui est bien plus un besoin, d’évoquer enfin ce qu’on a trop longtemps tu. C’est un procès de l’âge de fer, violent et arbitraire : on abat des coups de fourches sur les accusés absents, puis, en vrac, on balance toutes les obsessions dans un grand feu de joie. Voilà, pour l’oeuvre.
La bouche pleine de plancher
Quant à l’artiste, on ne sait pas vraiment sur quelles sources biographiques s’appuie Perrine Le Querrec, mais peu importe : on sent qu’il y a quelque chose de vrai sous cette histoire de père qui laboure sa fille comme le soc viole la terre et refuse à ses enfants l’enfance, l’amour et la liberté pour les cloîtrer dans une prison si infâme que même se battre en Algérie semble une échappatoire bienvenue ; on sent qu’il y a du vrai dans l’abandon de cette mère, dans l’abandon de cette soeur, dans l’abandon de ce village, dans l’abandon de la République, dans l’abandon de ce monde ; on sent qu’il y a du vrai, si ce n’est dans l’histoire, du moins dans l’humain.
Alors, grâce à la fiction du Plancher, on comprend toute la tragédie que sous-tend la réalité du Plancher. Quelle que soit l’expression, derrière elle, il y a le besoin : Jeannot la bouche pleine de plancher ; Perrine la bouche pleine de papier ; Paule et la mère, la bouche pleine de terre ; le père la gorge serrée de sang ; et plus loin, les deux cents et nous tous, les yeux pleins de merde. Le Plancher est un texte qui les ouvre.
Alors, grâce à la fiction du Plancher, on comprend toute la tragédie que sous-tend la réalité du Plancher. Quelle que soit l’expression, derrière elle, il y a le besoin : Jeannot la bouche pleine de plancher ; Perrine la bouche pleine de papier ; Paule et la mère, la bouche pleine de terre ; le père la gorge serrée de sang ; et plus loin, les deux cents et nous tous, les yeux pleins de merde. Le Plancher est un texte qui les ouvre.