Oui
de Thomas Bernhard
Dans le roman Le Tunnel, de l’Argentin Ernesto Sabato, il est question d’un tableau dans lequel une fenêtre, perdue dans un coin de la toile, laisse entrevoir une scène cachée qui constitue le véritable sujet de l’oeuvre. De la même façon, Oui, de l’Autrichien Thomas Bernhard, est une splendide mise en abyme. L’intrigue véritable de ce court roman d’une densité extraordinaire n’est révélée que dans le dernier tiers du livre, lorsque le narrateur commence à s’intéresser aux desseins d’un Suisse venu acheter, avec sa femme persane, un bout de terrain infâme dans la campagne autrichienne. Le fin mot du titre, quant à lui, sera le dernier du texte ; il ne manquera pas de laisser le lecteur sur le carreau.
Mais avant que ne soient révélés les plans de l’effroyable souricière, il faut nous confronter au texte. Cela commence par une première phrase où les apartés, les reprises, les redites, les répétitions, les ellipses, les anticipations et les retours s’enchaînent sur deux pages et demi avant que ne tombe enfin la sanction d’un premier point final. Le quatrième de couverture prétend que le test est révélateur : « ou bien nous lâchons prise, ou bien nous reprenons notre élan et nous ne pouvons plus nous arrêter avant la fin », est-il écrit. Pour moi, la langue, dans cette phrase à rallonge, est d’une telle clarté, ce qu’elle évoque d’une telle force, que je ne peux concevoir qu’on puisse être tenté de lâcher prise. Je ne peux même pas imaginer qu’on puisse désirer qu’elle fût écrite autrement. C’est que la langue est ici maniée avec une habileté inégalée. On croirait que ça coule naturellement, comme une pensée dont on rattrape le fil au fur et à mesure qu’on la perd, mais c’est s’illusionner. On ne peut qu’à grand peine imaginer le travail qu’une telle écriture doit impliquer pour que chaque répétition, chaque reprise permette d’étoffer un peu plus le propos, de rentrer plus profondément dans la psychologie du narrateur et de comprendre les intentions du couple suisse. Bernhard promène son lecteur dans tous les sens, lui fait sauter les étapes dans le temps et l’espace pour le ramener en arrière, revient plusieurs fois sur les mêmes points et tout s’enchaîne à la manière de la chanson pour enfants (trois p’tits chats, chapeau de paille, paillasson...) dans une boucle de laquelle on ne ressort plus. Le miracle, c’est que le tout, non seulement reste clair, mais se permet aussi d’être intéressant et même captivant. C’est un véritable tour de force !
Mais avant que ne soient révélés les plans de l’effroyable souricière, il faut nous confronter au texte. Cela commence par une première phrase où les apartés, les reprises, les redites, les répétitions, les ellipses, les anticipations et les retours s’enchaînent sur deux pages et demi avant que ne tombe enfin la sanction d’un premier point final. Le quatrième de couverture prétend que le test est révélateur : « ou bien nous lâchons prise, ou bien nous reprenons notre élan et nous ne pouvons plus nous arrêter avant la fin », est-il écrit. Pour moi, la langue, dans cette phrase à rallonge, est d’une telle clarté, ce qu’elle évoque d’une telle force, que je ne peux concevoir qu’on puisse être tenté de lâcher prise. Je ne peux même pas imaginer qu’on puisse désirer qu’elle fût écrite autrement. C’est que la langue est ici maniée avec une habileté inégalée. On croirait que ça coule naturellement, comme une pensée dont on rattrape le fil au fur et à mesure qu’on la perd, mais c’est s’illusionner. On ne peut qu’à grand peine imaginer le travail qu’une telle écriture doit impliquer pour que chaque répétition, chaque reprise permette d’étoffer un peu plus le propos, de rentrer plus profondément dans la psychologie du narrateur et de comprendre les intentions du couple suisse. Bernhard promène son lecteur dans tous les sens, lui fait sauter les étapes dans le temps et l’espace pour le ramener en arrière, revient plusieurs fois sur les mêmes points et tout s’enchaîne à la manière de la chanson pour enfants (trois p’tits chats, chapeau de paille, paillasson...) dans une boucle de laquelle on ne ressort plus. Le miracle, c’est que le tout, non seulement reste clair, mais se permet aussi d’être intéressant et même captivant. C’est un véritable tour de force !
L’effroyable solitude
L’auteur n’a en effet pas peur de noyer son sujet. Les deux premiers tiers du livre (et le dernier aussi, d’ailleurs, malgré la révélation du plan machiavélique) sont la description d’un cas clinique. Le narrateur, qui entretient bien des ressemblances avec Bernhard lui-même, se livre à une véritable logorrhée dans laquelle il évoque sa profonde dépression. A l’origine de celle-ci, la retraite qu’il s’est imposée pour mener à bien ses travaux scientifiques sur les anticorps et une erreur originelle :
« Et, c’est un fait, j’avais cru que je pourrais rester seul avec mon travail scientifique, que je pourrais tenir toute une vie uniquement avec mes études scientifiques, ce qui, peu à peu, puis, brusquement, avec la plus évidente certitude, devait se révéler totalement impraticable et totalement impossible. »
Voilà révélé le coeur apparent du roman : la difficulté pour l’homme d’une certaine sensibilité, d’une certaine intelligence, d’établir avec justesse son rapport au monde extérieur.
De l’usage de l’autre
Il y a le narrateur, tout d’abord, à l’intelligence et à la sensibilité exacerbées, tout en lucide introspection, et qui s’est évertué à se couper du monde jusqu’à s’apercevoir que « [q]uand la solitude n’a plus de sens, quand elle est tout à coup devenue improductive, il faut qu’elle cesse ». Alors, il s’accroche comme à une bouée à son ami Moritz, sur lequel il se déverse de tous ses états d’âme dans un discours incohérent, et il va jusqu’à se convaincre, dans une superstition qu’il sait totalement infondée, que lorsque deux inconnus débarquent alors qu’il se trouve au plus mal, ils sont venus exprès pour le sauver. Quelle folle certitude ! Est-il coulé pour le quasi-noyé qui s’y accroche à bout de souffle, le barreau d’échelle qui lui permet de se hisser hors du bassin où il n’avait plus pied ? Ou a-t-il simplement saisi le premier élément qui se présentait sous lui tandis que les flots le submergeaient ?
A l’autre bout du spectre, il y a le Suisse. L’incarnation froide et à peine humaine de la neutralité. L’ingénieur, le bâtisseur de centrales nucléaires et de blockhaus. Lui compense son désert intérieur par une volubilité et un sens du contact à toute épreuve. Il exhibe des photos où il serre les mains de chefs d’état, affiche une confiance sans faille, lie contact facilement. Mais ce n’est que la poupée pleine de vide d’une femme plus forte que lui qu’il finira par vouloir enfermer. Une femme qui, elle-même d’une grande richesse, n’existera pour le monde qu’à travers cet homme médiocre et misérable.
La toile de fond est tissée. Le besoin d’expansion des uns, la nécessité de contrôler des autres, Bernhard examine tous ces ressorts avec beaucoup de justesse et de sensibilité, et dévoile une grande connaissance de l’âme humaine (servie sans doute par un grand pouvoir d’introspection). Au final, il signe avec Oui une oeuvre splendide et importante.
A l’autre bout du spectre, il y a le Suisse. L’incarnation froide et à peine humaine de la neutralité. L’ingénieur, le bâtisseur de centrales nucléaires et de blockhaus. Lui compense son désert intérieur par une volubilité et un sens du contact à toute épreuve. Il exhibe des photos où il serre les mains de chefs d’état, affiche une confiance sans faille, lie contact facilement. Mais ce n’est que la poupée pleine de vide d’une femme plus forte que lui qu’il finira par vouloir enfermer. Une femme qui, elle-même d’une grande richesse, n’existera pour le monde qu’à travers cet homme médiocre et misérable.
La toile de fond est tissée. Le besoin d’expansion des uns, la nécessité de contrôler des autres, Bernhard examine tous ces ressorts avec beaucoup de justesse et de sensibilité, et dévoile une grande connaissance de l’âme humaine (servie sans doute par un grand pouvoir d’introspection). Au final, il signe avec Oui une oeuvre splendide et importante.
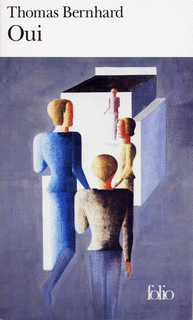
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire